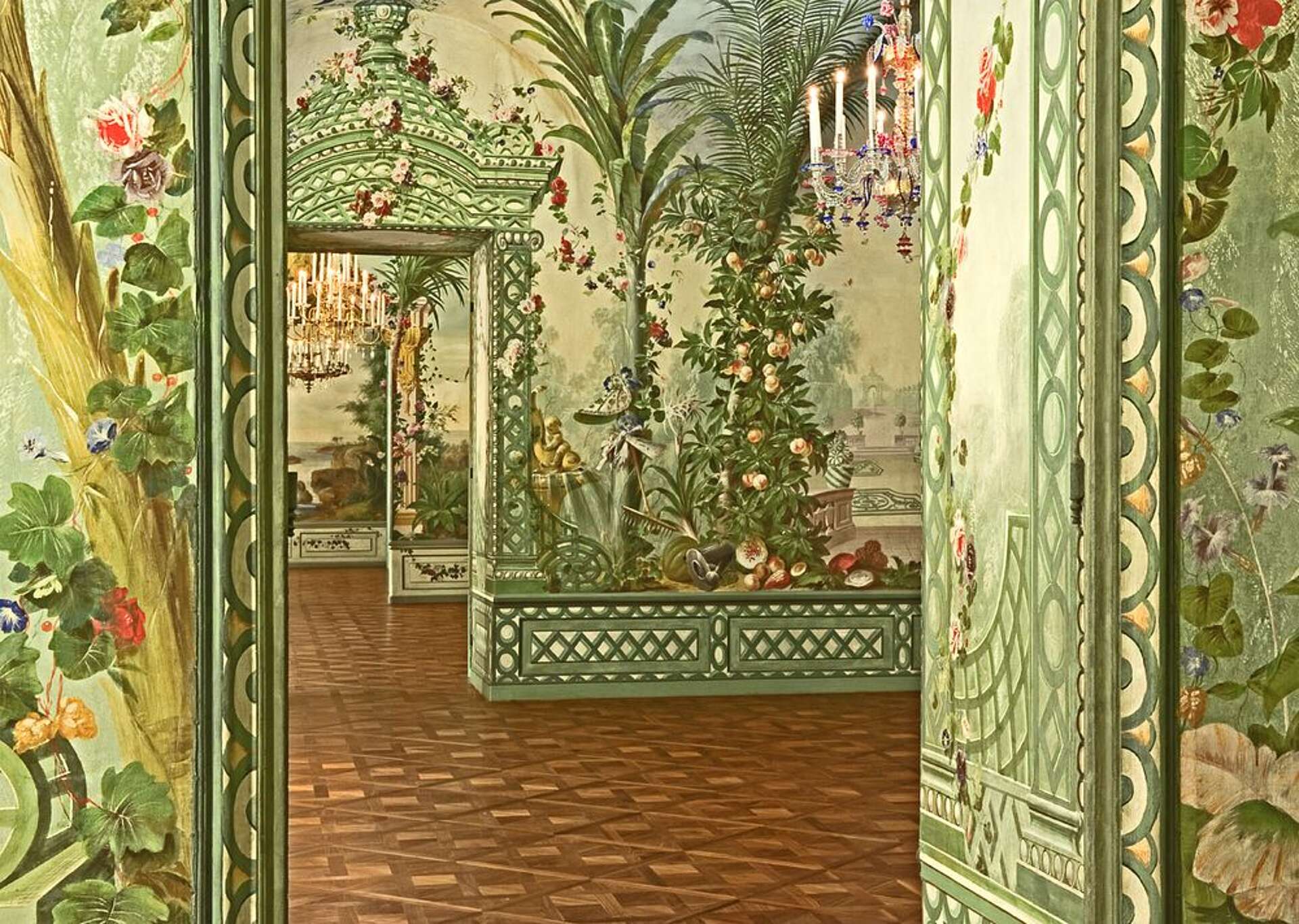Les cookies strictement nécessaires sont indispensables à l’utilisation des fonctionnalités fondamentales de ce site. Vous pouvez bloquer ou supprimer ces cookies dans les paramètres de votre navigateur ; toutefois, vous courrez le risque que certaines parties du site Internet ne fonctionnent pas correctement. Les informations stockées par les cookies ne servent pas à vous identifier personnellement. Ces cookies ne seront jamais utilisés a d'autres fins que celles indiquées ici.
PHPSESSID
Cookie strictement nécessaire du serveur Web. Expiration : Session. Typ : Typo3 Cookie.
cookieNoticeTech
Pour le contrôle du consentement aux cookies. Expiration : Session. Typ : custom.
cookieNoticeGA
Est employé pour vérifier si l’utilisateur accepte les cookies d’analyse. Expiration : Session. Typ : custom.
cookieNoticeFunctional
Est employé pour vérifier si l’utilisateur accepte les cookies de médias sociaux. Expiration : Session. Typ : custom.
cookieNoticeAll
Est employé pour vérifier si l’utilisateur accepte tous les cookies. Expiration : Session. Typ : custom.
LanguageRecognizer
Est employé pour reconnaître la langue de l’utilisateur. Expiration: 30 jours après la création. Typ : custom.
Lorsque vous visionnez les vidéos de YouTube et Vimeo intégrées sur notre site Web, une connexion est établie avec ces fournisseurs externes. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les liens suivants : https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr ou https://vimeo.com/cookie_policy
Nous utilisons Matomo pour analyser l’utilisation de notre site web.
- _pk_id : permet de reconnaître chaque visiteur du site (de manière anonyme : aucune donnée d’utilisateur à caractère personnel n’est enregistrée).
Type : cookie propriétaire persistant ; durée de conservation : 13 mois
- _Pk_ses : reconnaît quelles pages ont été affichées par le même utilisateur au cours d’une même visite
(de manière anonyme : aucune donnée d’utilisateur à caractère personnel n’est enregistrée).
Type : cookie propriétaire persistant ; durée de conservation : 30 minutes
- _pk_ref : ce cookie sert à faire le lien entre une visite et son référent (sa source).
Cela permet d’estimer les différences d’utilisation du site en fonction du site référent.
Type : HTML ; durée de conservation : 6 mois
- _pk_cvar : ce cookie sert à la transmission de variables définies par l’utilisateur,
par exemple des informations spécifiques au site (URL, titre de la page).
Type : HTML ; durée de conservation : 30 minutes
- _pk_hsr : ce cookie sert à la transmission d’informations concernant
l’utilisation de cartes thermiques. Il est optionnel.
Type : HTML ; durée de conservation : 30 minutes